Pour en finir (?) avec la théorie du surplus
 |
| Une reconstitution de la ville d'Eridu, en Mésoppotamie. L'essor des classes sociales et de l'Etat s'explique-t-il par l'augmentation de la productivité ? |
Après plusieurs mois passés à plancher sur ce thème qui me démangeait depuis déjà un certain temps, j'en suis arrivé au point où j'ai (enfin !) le sentiment que l'affaire est bouclée. Cela n'a pas été facile ; comme à chaque fois qu'on aborde un problème nouveau (ou un problème ancien sous un angle nouveau), on hésite à chaque pas, tout ce qu'on croit savoir, ou avoir appris, se trouve remis en question, on avale des dizaines d'articles scientifiques pour faire jaillir un peu de lumière, on triture les données dans tous les sens, et bien des fois, on se dit qu'on ne s'en sortira pas. Mais là, ça y est : j'en suis arrivé à un point où il me semble pouvoir assembler les pièces du puzzle de manière cohérente, et où cet assemblage a produit un (gros) article qui vient d'être adressé à une revue savante. Il me faudra quelques mois pour savoir si celle-ci l'accepte, et si le retour des rapporteurs anonymes ne ressemble pas surtout à un retour de bâton. Nous verrons bien. En attendant, voici un petit résumé de l'argument, dont j'ai déjà développé les principaux aspects dans différents billets de ce blog.
La thèse classique du surplus, qui fait partie du patrimoine marxiste, mais qui est très largement reprise au-delà de ce courant, énonce que la naissance des inégalités économiques, de l'exploitation puis des classes sociales, s'explique par l'évolution de la productivité. C'est son insuffisance dans les économies de chasse-cueillette qui explique que ces peuples, dont l'énergie était toute entière absorbée par la quête de nourriture et des moyens de survivre, ne pouvaient se payer le luxe d'entretenir des oisifs. Et c'est seulement avec son élévation (généralement consécutive au passage à l'agriculture) que les sociétés sont devenues capables de produire davantage qu'il ne leur fallait pour vivre, et donc, qu'elles secrétèrent une classe d'exploiteurs vivant du surtravail extorqué aux producteurs. L'augmentation de la productivité apparaît donc à la fois comme une condition nécessaire et suffisante de l'apparition de l'exploitation, puis des classes sociales. Or il me semble que dans cette théorie, tout, ou presque, se heurte aux faits.
Je commence donc par décortiquer le terme même de « surplus », dans lequel on fait souvent entrer des choses très différentes – en particulier, on assimile le fruit de l'exploitation à l'existence de stocks, une erreur d'autant plus tentante que toutes les sociétés à stocks étaient aussi des sociétés à exploitation. Mais si on veut avoir une chance de comprendre la causalité entre les deux phénomènes, la première chose à faire est de comprendre qu'il s'agit précisément de deux phénomènes, et non d'un seul. C'est à cette clarification que je procédais dans ce billet.
 |
| L'agriculteur romain, une productivité largement supérieure à celle des chasseurs-cueilleurs ? Voire... |
Je passe ensuite à la critique de l'idée selon laquelle l'augmentation de productivité était une condition nécessaire de l'exploitation, autrement dit, qui voudrait que si les sociétés de chasseurs-cueilleurs ou de cultivateurs égalitaires ne secrétaient pas d'exploiteurs, c'est parce qu'elles n'auraient pas pu se permettre d'en entretenir. Or, cette idée est contredite par plusieurs éléments. Tout d'abord, ainsi que le remarquait déjà A. Testart, même dans une société à la limite de la survie, les adultes valides entretiennent des improductifs, enfants et vieillards. Il y aurait donc toujours moyen, par définition, de tirer profit du travail d'un adulte capturé à la guerre. Or, ces peuples, même quand ils font la guerre (et ils la font plus souvent qu'on n'a tendance à la croire) ne font pas de prisonniers, et quand ils en font, ne les exploitent pas économiquement.
Un autre argument est celui que j'avançais tout à la fin de ce billet, sous le titre « La cerise sur le gâteau » : dans le cadre de rendements décroissants, il aurait suffi que le groupe soit un peu moins nombreux pour avoir une productivité plus élevée et donc, les moyens d'entretenir des quelques oisifs dominants. Enfin, une brève revue des éléments factuels tirés de l'ethnologie ou de l'archéologie permet de mettre en évidence que ces sociétés ont souvent pris soin d'infirmes, parfois durant de très longues années. Ainsi, dans le nord-est de l'Australie, un témoin du XIXe siècle raconte ainsi que : « Lors de ma première rencontre avec la tribu Dalleburra, je vis une femme qui semblait avoir 60 ans, qui était portée sur une litière tour à tour par les membres de la tribu ; elle était totalement paralysée depuis la naissance. On avait donc pris soin d’elle durant toutes ces années. » (Bennett M. M., 1927, “Notes on the Dalleburra Tribe of Northern Queensland”, The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 57 : 399-415).
Le point suivant est de taille : il s'agit de la surestimation de l'augmentation de la productivité durant l'époque Néolithique et les âges des métaux. Dès ce premier billet, je soulignais ce phénomène, et je tentais de montrer comment l'augmentation des rendements, avec lesquels on confond trop souvent la productivité, avaient pu jouer un rôle de premier plan dans la profitabilité de l'exploitation. Lorsque j'avais rédigé ce billet, il me manquait encore, cependant, une roue de l'engrenage : la raison sous-jacente à cette stagnation de la productivité, qui n'était pas encore clairement formulée. Ce fut chose faite avec le « piège malthusien », que j'ai exposé dans ce billet.
Enfin, contre l'idée que l'augmentation de la productivité serait, à elle seule, suffisante pour expliquer l'émergence de la stratification sociale, il suffit de rappeler qu'une telle augmentation, par elle-même, peut avoir bien d'autres effets, ainsi que l'illustre ce témoignage souvent cité sur les Yir Yiront du Cap York : « Tout temps de loisir [qu’ils] pouvaient gagner en utilisant des haches d’acier ou d’autres outils occidentaux n’était pas consacré à ‘améliorer les conditions de vie’ ou à développer l’esthétique, mais à dormir – un art dans lequel ils étaient passés maîtres. » (L. Sharp, 1952, “Steel Axes for Stone-Age Australians”, Human organization 11(2) : 17-22). Il faut donc, à la suite d'A. Testart, poser la question de la naissance des paiements, c'est-à-dire de la mise en place de mécanismes sociaux qui ont pu fournir à la fois l'incitation à exploiter son prochain sur une large échelle et les moyens de le faire. C'est le fait que les stocks, là où ils existent, ont toujours représenté un élément de ce basculement qui permet à la théorie du surplus de confondre stocks et surplus sociaux. Mais, comme le prouvent quelques exceptions, les stocks ne sont pas indispensables à l'émergence des paiements ; il faut donc envisager qu'ils ne soient qu'un cas particulier de biens ayant provoqué cette transition, biens que j'appelais W et dont je tentais de cerner les propriétés dans ce billet, prolongé par celui-ci.
Annexe : les surplus sectoriels et la division du travail
 |
| Une reconstitution de la hache de cuivre de Ötzi. La métallurgie marqua sans doute la naissance de la division sectorielle du travail. |
Dans une première version de mon article, je discutais sur quelques paragraphes l'idée très ancienne (elle remonte au moins à Turgot) selon laquelle la division du travail procède des surplus dégagé par la production alimentaire – pour faire simple, l'agriculture. Mon article étant trop long, je l'ai recentré sur le thème principal (productivité et surplus social), et la partie sur la division du travail a été supprimée. Plutôt que la conserver dans un coin de mon disque dur (si tant est qu'un disque puisse avoir un coin), je la reproduis ici, en attendant, un jour peut-être, de pouvoir la réutiliser dans un cadre plus officiel (NB : le texte étant au départ destiné à une revue académique, le style est un peu plus ampoulé que celui que j'utilise sur ce blog, mais je ne voyais pas l'intérêt de tout réécrire).
Commençons par le raisonnement qui voit dans l’existence d’un surplus sectoriel la condition de la division du travail – celle-ci étant, au passage, souvent assimilée à l’échange marchand. Cette idée, qui remonte au moins à Turgot (1913 : 282) mais qui fut maintes fois reprise depuis lors, est loin d’être aussi évidente qu’il y paraît.La première difficulté tient à la nature précise du lien causal. Dire qu’il ne peut y avoir de division du travail sans surplus sectoriels, c’est dire que ces surplus représentent une condition nécessaire de la division du travail. Mais la causalité entre surplus et division du travail peut fort bien, en réalité, s’exercer en sens inverse, ce qu’un cas ethnographique imaginaire pourra illustrer. Soit deux groupes de chasseurs-cueilleurs, l’un vivant sur le littoral, l’autre en forêt. Au départ, les deux groupes n’entretiennent pas de relation et vivent en autarcie ; il n’existe donc aucun surplus sectoriel. Peu à peu, ils nouent des rapports de bon voisinage. Des échanges surviennent : les pêcheurs prennent l’habitude de donner une partie de leurs prises aux gens de la forêt, en contrepartie de gibier. À l’issue du processus, sans qu’aucune modification ne soit intervenue dans les quantités produites, deux surplus sectoriels ont fait leur apparition. Ceux-ci ne sont par conséquent qu’un simple effet de la fin de l’autarcie de chaque communauté – donc, de l’instauration d’une division du travail – et non sa cause.Le raisonnement reste le même si au lieu de mettre face à face deux productions alimentaires, on postule que l’une d’elles est d’ordre artisanal. Dans une communauté où chaque individu passe un cinquième de son temps de travail à produire des outils (le reste étant consacré à la production de nourriture), une division du travail peut apparaître, qui spécialise les quatre cinquièmes de la population dans la production alimentaire et le restant dans l’artisanat sans que ces productions soient modifiées. Dans ce cas, là encore, les surplus sectoriel ne sont pas la cause, mais la conséquence de la division sociale du travail.On ne saurait cependant utiliser cet argument pour disqualifier tout rôle causal du surplus sectoriel dans la division du travail, quelles que soient les circonstances, ainsi que le fait Alain Testart (1985:52-53). Celui-ci suppose en effet implicitement que tout progrès de la division du travail – en particulier, toute croissance de la sphère non alimentaire – découle de la spécialisation d’une activité préexistante et jusque-là effectuée par les producteurs alimentaires. Mais ce faisant, on évacue par hypothèse le problème au lieu de le résoudre, ce qui apparaît lorsqu’on considère l’évolution de la répartition du travail social sur le très long terme. Dans les pays les plus développés, les agriculteurs représentent de nos jours moins d’un vingtième de la population active. Depuis l’ère industrielle à tout le moins, la part du travail social consacré à la production alimentaire s’est réduite d’une manière drastique, avec pour corrélat un accroissement considérable de la productivité du travail agricole. Sans celle-ci, un tel mouvement aurait été impossible. Il n’est donc pas légitime de raisonner comme si toute évolution de la division du travail se résumait à une simple modification de sa répartition sociale à technique constante. L’activité non alimentaire peut fort bien être une activité nouvelle, qui n’était pas auparavant assumée par les producteurs de nourriture ; les questions de l’innovation technique, de la productivité (et de ses éventuels blocages) se posent donc bel et bien.Le statut du surplus alimentaire dans la division du travail est donc loin d’être aussi simple qu’on a souvent voulu le croire ; mais comme une difficulté peut en cacher une autre, il faut également souligner que le surplus alimentaire n’est pas le seul en cause. Rappelons en effet que les différentes branches qui participent à la division du travail occupent des positions symétriques. Le surplus sectoriel des unes doit nécessairement avoir pour contrepartie le surplus sectoriel des autres. Dans une société divisée entre cultivateurs et métallurgistes, les premiers doivent être capables de produire suffisamment pour nourrir l’ensemble de la population ; mais les métallurgistes, eux aussi, doivent être capables de produire pour l’ensemble de la collectivité. En cas de blocage, il n’y aucune raison de privilégier a priori l’hypothèse que celui-ci provienne du secteur alimentaire plutôt que de la métallurgie. Dans une communauté d’agriculteurs installée dans un milieu favorable et qui, avec relativement peu d’efforts, se nourrit convenablement, l’absence de la métallurgie a bien d’autres causes possibles qu’une insuffisance de la production agricole. Le savoir technique nécessaire à l’extraction ou à la fonte du minerai n’est peut-être pas connu dans le village. De manière encore plus triviale, peut-être n’existe-t-il aucun minerai disponible dans la région, ou peut-être faut-il le faire venir de si loin que toute utilisation en est prohibitive.L’impossibilité de dégager un surplus alimentaire sectoriel suffisant est donc une cause possible, mais non exclusive, d’un blocage de l’innovation technique ou de la division du travail. Reste à expliquer pourquoi, depuis deux siècles, ce facteur a reçu une attention privilégiée, sinon exclusive. La réponse tient sans doute à l’idée plus ou moins implicite que la nourriture représente le plus élémentaire de tous les besoins humains et que sa production, à l’origine, absorbait la totalité du travail disponible. Dès lors, toute émergence d’une activité spécialisée est apparue conditionnée par l’émancipation vis-à-vis de cet état initial.On a déjà relevé les limites que rencontrait ce raisonnement sur le plan logique. Il faut y ajouter un argument empirique essentiel : aucune société humaine connue ne consacrait l’intégralité de son travail productif à la production de nourriture. La fabrication d’outils, de vêtements ou d’habitations – sans parler d’objets d’art profanes ou religieux – occupait partout une place non négligeable. Bien évidemment, les statistiques sont rares ; l’ethnographie classique n’en donne que des indices indirects, en décrivant les productions matérielles non alimentaires jusques et y compris pour les chasseurs-cueilleurs les plus démunis sur le plan technique ; quant à l’archéologie, elle sait depuis longtemps que la fabrication d’outils remonte à une époque si lointaine qu’elle y a fréquemment vu la marque distinctive de la lignée humaine. Durant les dernières décennies, quelques études ont tenté d’évaluer le temps que les chasseurs-cueilleurs consacraient à leurs différentes activités. Si entachées d’incertitudes soient-elles, elles convergent néanmoins pour estimer la part du temps de travail consacrée à la fabrication et à la réparation des outils à un peu moins d’un dixième (Hawkes et al. 1997, Hill et al. 1985, Lee 1979).Ces chiffres plaident contre l’idée que l’absence de division du travail – hormis celle qui intervient entre les sexes et qui structure ces sociétés – serait due à l’insuffisance de la productivité alimentaire. Des sociétés où chaque individu consacre près d’un dixième de son temps à la fabrication d’outils auraient probablement la capacité de spécialiser un dixième de leurs membres dans cette activité (qu’elles y aient intérêt est une autre question). On ne peut certes formellement exclure que la chasse soit une activité si épuisante qu’elle doive être répartie pour être efficace, et que sa mise en œuvre par une fraction plus réduite de la société, chargée d’approvisionner quelques artisans à plein temps, poserait un problème de productivité. Cette hypothèse paraît toutefois peu crédible. D’abord, parce qu’à côté de la chasse (et, très souvent, bien davantage qu’elle), c’est la cueillette qui assure l’essentiel de l’approvisionnement. Ensuite, parce que la chasse elle-même n’exige pas toujours une forte dépense d’énergie. Enfin, parce que les individus productifs de ces sociétés, hommes ou femmes, assurent déjà l’approvisionnement des inactifs (vieillards, enfants, malades…) et qu’une augmentation de moins de 10% de cette charge paraît se situer largement dans le domaine du possible. En fait, comme on l’a déjà dit, hors de l’insuffisante productivité alimentaire, il existe bien des raisons possibles, et beaucoup plus vraisemblables, à l’inexistence d’un artisanat spécialisé dans ces sociétés.Concluons. La théorie qui fait du surplus sectoriel alimentaire la variable déterminante de la division sociale du travail considère comme un facteur central, si ce n’est unique, la productivité alimentaire – une idée qui se fonde largement sur la conception erronée selon laquelle l’économie primitive aurait été entièrement consacrée à la production de nourriture. Or, si l’on ne saurait nier que la productivité alimentaire peut constituer, à titre général, une condition de l’accroissement de la division sociale du travail, il ne s’ensuit pas que celle-ci dépendrait uniquement d’elle. La productivité des autres branches de production, entre autres facteurs, est tout aussi cruciale, et seule l’étude des situations concrètes peut déterminer au cas par cas où se situe l’éventuel blocage.


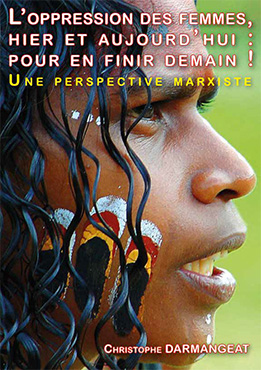

Aucun commentaire